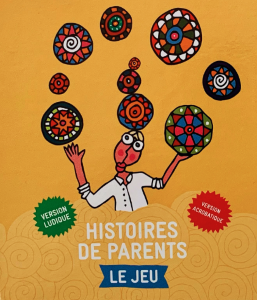Numéro 693, 22 janvier 2004
Faut-il des parents à tout prix ?
Pour certains, maintenir absolument des liens entre l’enfant et ses géniteurs est vital. Pour d’autres, il faut au contraire rompre une relation à partir du moment où elle s’avère problématique. La réponse à ces dysfonctionnements parentaux se situe plus probablement entre ces deux extrêmes et ne relève pas d’une recette applicable à tous. Le dernier livre de Maurice Berger [lire interview] a provoqué la controverse dans le milieu de la protection de l’enfance. Il nous a semblé utile de donner la parole à son auteur, ainsi qu’à l’un de ses contradicteurs, Fréséric Jésu, pédopsychiatre [lire interview]. Mais au préalable, il est intéressant de réfléchir à ce qui constitue le soubassement de la polémique : les parents sont-ils indispensables à l’équilibre de l’enfant ?
« Frédérique laissait sa fille âgée de deux ans et demi, seule et nue dans la salle de bains, après l’avoir barbouillée de ses excréments. Elle la faisait manger dans les waters, la laissait nue dans le grenier sur un matelas souillé d’urine, la frappait à coup de pieds et de poings, lui donnait des gifles pour un oui ou pour un non. C’est le père de l’enfant qui a dénoncé son épouse, avant d’être lui-même condamné pour avoir abusé sexuellement de la fillette » [1] Une telle description dépasse l’entendement. Que se passe-t-il dans la tête de parents, pour qu’ils agissent ainsi ? Certes, l’être humain semble doté de facultés lui permettant de faire preuve de la créativité la plus extraordinaire mais aussi d’une destructivité invraisemblable, d’une sensibilité d’une grande finesse mais aussi d’une brutalité et d’une cruauté sans grande retenue. Mais quand même, de là à s’attaquer à son propre enfant !
Contrairement à une conviction profondément ancrée dans une société qui a transformé l’enfant en valeur absolue, les rapports intra familiaux et notamment le lien parent-enfant n’a absolument aucune raison d’échapper à l’ambivalence fondamentale qui gît au cœur de tout un chacun. On a pu essayer de faire accroire à un instinct maternel qui serait au fondement de la nature féminine. La maternité a longtemps été opposée aux femmes comme étant la raison d’être de leur existence, culpabilisant celles qui ne sentaient pas en elles l’appétence nécessaire au contact avec des enfants. On sait aujourd’hui qu’il s’agit là d’une pure construction culturelle : l’altruisme et le sacrifice naturel au profit de sa progéniture ne sont que des stéréotypes. Dans un livre très documenté [2], Sarah Blaffer Hrdy explique que, contrairement aux singes femelles capables de continuer à porter pendant des jours le corps en décomposition de leur petit décédé, les mères humaines ont fait preuve, tout au long de l’histoire, d’une sollicitude bien plus discriminante. Ainsi, de ces cultures qui soumettaient les bébés à des tests de viabilité (en les trempant dans des bains d’eau glacée) ou qui catégorisaient les enfants malades comme autre chose qu’un humain (un imposteur laissé par des lutins à la place des enfants en bonne santé), ce qui leur permettaient de les délaisser et de les laisser mourir. Faut-il rappeler, en outre, les coutumes d’une civilisation grecque, considérée comme fondatrice de nos valeurs occidentales, et qui consistaient à jeter dans une fosse spécialement prévue à cet effet, tout nourrisson non désiré par le père ? A l’issue de sa longue étude à la fois historique et ethnologique, Sarah Blaffer Hrdy aboutit à une terrible conclusion : d’une façon générale, les mères tuent d’autant plus facilement leurs enfants qu’il n’existe pas d’autres formes de contraception et qu’elles sont confrontées à l’absence de toute possibilité de relais et de délégation des soins confiés à une tierce personne. On comprendra, dès lors, que toute tentative pour naturaliser le rapport parent-enfant constitue un leurre dangereux qui peut se retourner contre l’enfant, quand on ne prend pas en compte la possibilité pour un parent génétique de ne pas assurer son rôle.
L’objet de la polémique concerne le sort des 300 000 enfants et adolescents bénéficiant du dispositif de protection de l’enfance : est-il nécessaire ou non de maintenir à tout prix les liens avec leur famille ? Ce maintien constitue-t-il ou non l’un des fondements de l’équilibre et de l’épanouissement de ces jeunes ? Mais, curieusement, peu de monde se préoccupe des 600 000 enfants issus de couples divorcés qui ne voient plus du tout leur père, ni des 400 000 qui ne le voient qu’une seule fois par mois. Certes, pourra-t-on répondre, ils continuent à avoir auprès d’eux au moins l’un des deux parents. De fait, malgré la difficulté que peut représenter le fait d’être coupé d’une partie de ses racines, cette absence est très souvent compensée par la présence d’un beau-père ou, dans le cas de familles monoparentales, d’une figure masculine forte (grand-père, oncle, parrain,…), autant de personnes sur qui l’enfant peut compter pour trouver un équilibre, malgré tout. Pour comprendre ce qui se joue alors, il est intéressant de reprendre la démonstration faite par Serge Lesourd, à l’occasion des journées tenues à Nîmes par le Grape en 1995 [3]. Au départ, y expliquait-il, il y a un acte biologique : la conception. Puis, vient l’appartenance qui constitue un acte fondateur de la part des adultes qui identifient l’enfant en le nommant dans un pacte symbolique qui l’inscrit dans une lignée : c’est la filiation. L’affiliation, elle, se situe plus au niveau affectif : c’est le lien d’amour et de dépendance, de reconnaissance et d’identification à l’égard d’adultes fiables, sécurisants et protecteurs. Habituellement, ces trois niveaux se manifestent à l’égard des mêmes personnes qui sont les parents : les géniteurs sont donc à la fois filiateurs et affiliateurs. Mais, on peut être géniteur sans être ni filiateur, ni affiliateur : cela prend la forme de l’abandon. On peut aussi être filiateur et affiliateur sans être géniteur : c’est la situation des adoptants. On peut enfin être affiliateur sans être ni géniteur, ni filiateur : cela peut se passer dans le cadre d’une famille d’accueil, par exemple. Ces strates ne doivent être ni confondues, ni hiérarchisées, ajoute-t-il, mais conçues comme autant d’étapes permettant à l’enfant de se construire. Elles sont tout aussi importantes les unes que les autres. Reconnaître chaque partenaire pour ce qu’il est, en ne le chargeant pas d’un rôle qu’il ne peut remplir semble être la meilleure façon de répondre à l’intérêt de l’enfant. Si l’on suit ce raisonnement, on peut parfaitement concevoir que des parents puissent être géniteurs et inscrire l’enfant dans une filiation, mais que l’affiliation se déroule ailleurs que sur la scène familiale d’origine. Il n’y a, dès lors, pas de compétition entre des instances qui se disputeraient l’appartenance de l’enfant, mais une complémentarité entre des niveaux différents et tous nécessaires. Seulement, cette situation n’est pas celle que l’on retrouve le plus souvent. Ce qui pose problème et nous intéresse ici, c’est bien lorsque le géniteur tente de jouer son rôle d’affiliateur et qu’il n’y arrive que très partiellement ou d’une façon très destructrice pour l’enfant (ce qui a nécessité la séparation).
Il est vrai que l’action des travailleurs sociaux s’appuie sur une conviction essentielle : il est toujours possible de faire émerger les capacités enfouies, tout individu ne fonctionnant jamais à son niveau optimum et disposant ainsi d’une réserve potentielle pour faire face aux problèmes auxquels il est confronté. Mais, il serait abusif d’étendre ce postulat à la parentalité. D’abord parce que s’il est vrai qu’on peut se mobiliser pour donner un autre cours à sa propre vie, il est bien plus aléatoire de penser qu’on puisse forcément le faire pour autrui. Et exercer un rôle de parent, cela ne concerne pas que soi. Cela implique aussi le rapport à l’enfant. On peut même dire que cela nécessite de se décentrer suffisamment pour répondre aux besoins de celui-ci. Certaines personnes ont déjà assez de mal à s’engager dans un processus de changement pour eux-mêmes, n’est-il pas parfois déraisonnable de leur demander de le faire pour leurs propres enfants ? Ensuite, il existe des adultes qui sont rendus littéralement malades psychiquement par le fait d’avoir un enfant qui vient réactiver (à son corps défendant) les sentiments de désorganisation et d’angoisse qui remontent à leur propre jeunesse. Ce petit être devient très vite pour eux leur pire cauchemar, sa seule existence représentant alors une menace pour leur équilibre. Leur demander d’établir un lien parental, c’est les mettre en grande difficulté. Enfin, il faut quand même le proclamer bien fort : tout être humain a le droit indéfectible de ne pas pouvoir (ou vouloir) éduquer un enfant et de ne pas pouvoir (ou vouloir) l’assumer. Cela peut choquer. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Jean-Jacques Rousseau, considéré comme l’un des fondateurs de l’éducation moderne, qui n’avait pas assez de violence pour dénoncer le placement -courant à son époque- des enfants en nourrice, n’a guère eu de problèmes moraux à abandonner, coup sur coup, trois des siens ! Il est donc tout à fait impossible de considérer que les parents disposeraient d’emblée et par essence des compétences nécessaires pour éduquer leur enfant. Ils peuvent les acquérir. Mais ils peuvent aussi ne jamais se montrer capables d’une telle tâche. Trop de facteurs entrent en ligne de compte pour leur permettre ou au contraire les empêcher de jouer pleinement leur rôle. Alors, quelle attitude adopter face aux parents développant une parentalité inadéquate ?
Il faut sortir de l’alternative qui voudrait que les parents soient pathologiques par définition ou compétents par essence. Le principe à privilégier quand ils rencontrent des difficultés, c’est de considérer qu’ils peuvent être à même de renforcer leurs capacités ou incapables de le faire. Tout le travail des professionnels consiste alors à évaluer ce potentiel. Tâche délicate et risquée, car pouvant déboucher sur deux dérives : soit ne pas identifier les compétences et priver l’enfant de liens qu’il aurait pu avoir, soit les surévaluer et renforcer la souffrance et les difficultés de ce dernier. Si un travail s’avère possible pour permettre de développer cette parentalité, alors les professionnels doivent s’engager dans un travail patient et si nécessaire de longue haleine. S’il s’avère qu’une problématique trop lourde ne pourra pas amener des parents à dépasser leurs dysfonctionnements, alors ils doivent être respectés y compris dans leurs inaptitudes, plutôt que d’être destinataires d’exigences qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer. Mais, en aucun cas, leurs enfants ne doivent être sacrifiés sur l’hôtel de leur supposées aptitudes qu’il s’agirait à tout prix de faire émerger. Une étude réalisée par la psychiatre Marthe Coppel [4] sur une population d’enfants placés pour raison sanitaire dans un centre spécialisé éloigné du milieu familial, démontre que l’évolution et l’équilibre de l’enfant devenu adulte n’ont que peu à voir avec l’existence ou non de contacts familiaux au moment de l’enfance. Certains d’entre eux semblent avoir digéré le traumatisme de la séparation, d’autres en souffrent encore. Mais, et cela est très important à noter, il est impossible d’établir un rapport de causalité avec le maintien ou non de relations avec leur famille. Au contraire, ce qui semble avoir été le plus néfaste, c’est l’irrégularité dans les rencontres. Un peu comme si les enfants avaient vécu de façon équivalente pour leur développement, tant des relations suivies que des relations durablement distendues, mais que ce qu’ils ont le moins supporté, ce sont des contacts intermittents et irréguliers. Autrement dit, ils auraient réussi à s’équilibrer à partir de liens fréquents ou quasiment inexistants, mais que le pire aurait été de renouer plusieurs fois des liens qui s’effilochaient ensuite.
Alors, faut-il maintenir ou non les liens ? Il apparaît bien impossible de donner une réponse générale et définitive. Loin des déclarations purement idéologiques, des anathèmes et des procès en sorcellerie, ce qui est essentiel, c’est d’évaluer la situation de chaque enfant comme une problématique à chaque fois unique, justifiant d’une solution répondant au mieux à ses besoins propres et non pas de le faire entrer de force dans les cases d’une théorie. C’est de réfléchir, hors de tout carcan enfermant pour l’esprit, à ce que son équilibre et son épanouissement commandent et d’agir en conséquence, même si cela va à l’encontre des idées reçues.
Jacques Trémintin
[1] Ouest France, 18 novembre 2003
[2] « Les instincts maternels » Sarah Blaffer Hrdy, Payot, [lire la critique]
[3] « Pour-suivre les parents des enfants placés » Denise Bass, Arlette Pelé, 1996, érès
[4] « Que sont-ils devenus ? Les enfants placés de l’Oeuvre Grancher » Marthe Coppel et Annick Camille Dumaret, érès, 1995.