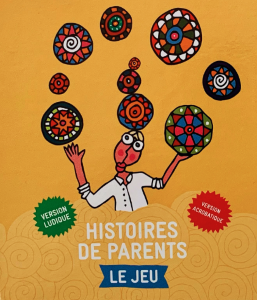Le procès des assises du Pas-de-Calais, qui devait être une étape importante dans le calvaire de dix-huit enfants victimes d’agression sexuelle, s’est transformé en un véritable désastre judiciaire. Sur les dix-sept adultes jugés pour avoir participé à un ignoble trafic de chair humaine, quatre ont reconnu leur culpabilité, les treize autres qui proclamaient depuis le début leur innocence, ont vu, tout au long des audiences, le doute grandir quant à leur implication réelle dans cette sinistre affaire. Ceux d’entre eux qui étaient incarcérés depuis trois ans ont été remis en liberté avant même la fin du procès. Exit la participation au réseau pédophile du prêtre-ouvrier, de la boulangère, du chauffeur de taxi, de l’huissier, de l’infirmière scolaire etc. ? Il revient au jury d’avoir à en décider. Le verdict qui sortira de ces délibérations pourra à son tour être frappé d’appel et nécessiter un nouveau procès. Si la vérité judiciaire n’est donc pas à la veille d’être définitivement établie, il y a d’ores et déjà eu une condamnation : c’est la parole de l’enfant. Selon un mouvement de balancier assez courant dans notre société, la presse et l’opinion publique qui, hier encore, n’écoutaient guère les protestations d’innocence de certains adultes mis en cause, par refus de douter du témoignage des mineurs victimes, n’ont pas aujourd’hui de mots assez durs pour le mettre en doute. Loin du battage médiatique, on peut établir trois certitudes. Tout d’abord, un certain nombre d’enfants ont subi des agressions sexuelles : quatre de leurs agresseurs l’ont reconnu. Ensuite, des adultes ont été accusés à tort. Ils ont été traînés dans la boue. Certains ont subi trois années d’incarcération. L’un d’entre eux s’est même suicidé en prison. Enfin, l’institution judiciaire a fait preuve dans cette affaire d’une impressionnante incompétence : tant au niveau de l’enquête par les services de police que de l’instruction par le magistrat mais aussi des expertises psychiatriques et psychologiques. Ces événements pourraient bien avoir un impact considérable sur le quotidien des travailleurs sociaux : quelle crédibilité dorénavant accorder aux révélations de l’enfant ?
Durant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, les agressions dont était victime l’enfant au sein de sa famille sont restées un sujet tabou. Ce n’est qu’en 1989, que la loi a instauré un véritable dispositif de protection de l’enfance maltraitée, digne de ce nom. Après des décennies d’aveuglement, quand le rideau s’est levé sur l’inceste et sur les enfants victimes d’abus sexuels et de mauvais traitements, nombre de travailleurs sociaux, de psychologues, de juges ont ressenti une forte culpabilité en se souvenant des situations dont ils avaient été témoins et qu’ils n’avaient pas à l’époque prises en compte. C’est que pendant longtemps, la parole de l’enfant a été considérée comme peu fiable. Combien de procès, dans le passé, ont réfuté des témoignages d’enfants parce que des psychiatres ou psychologues prétendaient qu’ils ne pouvaient avoir la moindre crédibilité ? Depuis une vingtaine d’années, retournement de situation : on accorde, à juste titre, crédit à cette parole. Mais, tout se passe comme si on était passé d’un extrême à l’autre : de « l’enfant ne peut que mentir », on préfère aujourd’hui « l’enfant dit toujours la vérité. » Entre les deux convictions opposées, chacun est sommé de choisir son camp. Dans un essai paru en 1999, par ailleurs tout à fait intéressant [1], Catherine Bonnet assimilait la moindre interrogation sur cette question comme partie intégrante de l’offensive d’un « courant pro-agresseur » qui « influence insidieusement de nombreux professionnels en contact avec les enfants » et qui se fixe pour objectif de faire « à nouveau régner le temps des enfants menteurs et vicieux. »
À la question : l’enfant dit-il la vérité ou ne la dit-il pas ? On ne peut répondre d’une manière univoque. Tout simplement, parce que cette « vérité » se décline de multiples manières.
Il y a d’abord ce que dit l’enfant. Dans l’immense majorité des cas son propos correspond à la vérité. Mais il arrive parfois que la confusion s’empare de son témoignage. Ce qu’il exprime, c’est avant tout sa souffrance et son mal-être. On le constate en permanence dans nos professions : un enfant qui va mal ne trouve pas forcément les mots adéquats pour le dire. Il utilise parfois comme seul moyen d’expression, les passages à l’acte. Les voies qu’il emprunte alors peuvent être auto-agressives (somatisation, tentative de suicide, anorexie ou boulimie…) ou hétéro agressives (délinquance, violence contre autrui, attaque des liens sociaux…). Ce mode de fonctionnement n’est pas différent quand l’enfant est victime d’agression physique ou sexuelle. Combien de situations de maltraitance ont-elles été découvertes alors que ce qui était évoqué initialement, c’était une dépression ou encore des agressions dont l’enfant ou le jeune se rendait lui-même coupable ? Quand elle finit par révéler ce qu’elle subit, la victime dénonce souvent directement ses tortionnaires. C’est le cas le plus fréquent. Mais elle peut aussi désigner une tierce personne, par peur des représailles des vrais auteurs ou simplement pour éviter de leur nuire. Car ce qu’elle désire avant tout, n’est pas tant se venger, que de retrouver une relation saine et ordinaire avec les auteurs qui sont dans 80 % des cas les êtres qu’elle chérit le plus au monde : ses parents. Sans compter que la perte de repères due à l’agression subie provoque le brouillage de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas : quand ceux qui sont censés protéger se transforment en persécuteurs, le moindre geste affectueux d’un adulte peut devenir suspect. Il lui arrive aussi parfois de revenir sur ce qu’elle a vécu, quand la victime se rend compte des conséquences de ce qu’elle a déclenché (incarcération de l’agresseur qui est un proche que la plupart du temps elle aime, éclatement de sa famille qui la rend responsable de ce qu’elle endure…). C’est bien cette réalité complexe qui est à la source des circonvolutions que peuvent suivre ses déclarations. Peut-on dire alors que l’enfant ment ou doit-on plutôt comprendre qu’il essaie de dire sa vérité à lui ? Une attention particulière doit être accordée aux révélations des adolescent (e) s. Non qu’une suspicion systématique doive là aussi, dorénavant, accueillir leurs révélations. Mais un certain nombre de caractéristiques peuvent plus particulièrement expliquer les cas, à cet âge, d’affabulations : elles restent, malgré tout, très minoritaires. Le réveil des pulsions, à la puberté, peut provoquer des désirs sexualisés à l’égard de certains adultes : c’est le beau professeur ou l’animatrice si sympa dont on tombe facilement amoureux quand on a 15 ou 16 ans. Il y a aussi une sensibilité nouvelle à des situations de proximité physique qui peuvent faire naître des gênes bien plus rapidement que chez le petit enfant. Certaines prises nécessaires en gymnastique au sol, par exemple, ont pu dans les collèges et les lycées, faire regarder avec suspicion des enseignants de sport. Et puis, il y a cette opposition à l’adulte, cette contestation de son autorité, cette recherche des limites qui peut amener la (le) jeune à chercher très loin la confrontation, y compris en utilisant une arme qui semble l’affaiblir tout particulièrement : faire courir à son égard des rumeurs sur des gestes déplacés. Mais, là encore, ce n’est pas tant l’adolescent (e) qu’il faut incriminer, c’est plutôt la psychose qui s’est emparée du monde des adultes qui en est venu à considérer tout mâle comme un pédophile en puissance.
Et puis, il y a la vérité des enquêteurs. Dans un article paru dans Lien Social n°678 (« Pour un recueil respectueux de la parole de l’enfant »), nous évoquions les nombreux biais qui peuvent induire une manipulation de sa parole. Que ce soit ses capacités linguistiques limitées qui l’amènent à acquiescer même s’il n’a pas compris la question, l’immaturité de sa mémoire (surtout s’il est très jeune) moins apte qu’un adulte à gérer et à hiérarchiser à la fois les informations récentes et celles qui sont plus anciennes, sa forte suggestibilité qui implique que tout propos inducteur peut contaminer définitivement son récit, l’habitude qui lui a été inculquée, pendant des années, de ne pas contredire l’adulte (ce qui le fait répondre automatiquement oui aux questions posées…). L’ensemble de ces éléments n’implique aucunement que son propos ne soit pas fiable. Il démontre simplement la nécessité d’une solide formation de la part des enquêteurs. Le désastre du procès d’Outreau en démontre la criante obligation. Ce qui est en cause ici, ce n’est absolument pas l’enfant, ni ce qu’il révèle, mais la capacité des enquêteurs qui recueillent sa parole à suivre un protocole exigeant, à se détacher de leurs propres émotions, de leurs préjugés et de leur système explicatif pour être vraiment à l’écoute de ce que dit l’enfant et non pas d’entendre ce que eux adultes ont de toute façon décidé d’entendre. La parole ainsi recueillie est ensuite transmise à la justice qui va devoir établir la vérité judiciaire. Rappelons tout d’abord, qu’une part considérable (jusqu’à 80 %) des affaires de révélation d’agressions sexuelles sont classées sans suite. Cela ne signifie pas que l’enfant a menti, mais que l’enquête n’a pas permis de réunir les éléments de preuves suffisants, mis à part la parole de l’enfant contre la parole de l’agresseur présumé. Quand ces plaintes arrivent malgré tout en jugement, tout est mis en œuvre pour que le verdict de culpabilité ou d’innocence corresponde à la vérité. Les garanties que l’État de droit propose devraient a priori le permettre : principe du contradictoire faisant une large place à la défense, possibilité de faire appel en seconde instance, vérification de la légalité en cassation, recours possible auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire d’Outreau, si elle montre les limites de l’enquête et de l’instruction, apporte aussi la preuve que tout n’est pas joué d’avance et que les débats du procès peuvent faire avancer la vérité. Mais, la justice étant humaine donc faillible, on sait qu’il arrive trop souvent que des coupables soient relaxés et des innocents condamnés. Être « blanchi » par un tribunal ne signifie pas pour autant qu’on n’a pas commis les actes pour lesquels on a été mis en examen. Et inversement, l’on peut faire de nombreuses années de prison pour un crime que l’on n’a pas commis.
Vient ensuite la vérité du thérapeute. Il est tenu par la loi, comme tout citoyen, de faire un signalement s’il est le destinataire d’une révélation d’agression sexuelle ou de mauvais traitement. Mais là n’est pas sa fonction professionnelle première. Ce qui compte pour lui, ce n’est pas tant ce qui s’est réellement passé, mais ce qui provoque la souffrance du sujet qu’il reçoit. Ce sur quoi il agit ce n’est pas sur la réalité, mais sur les représentations que s’en fait la personne. Peu importe, finalement, que ce soit vrai ou pas, puisque c’est cela qui fait souffrir. C’est donc là où il faut intervenir. Cette logique tout à fait cohérente est illustrée par les psychanalystes : c’est en allant aux sources des difficultés psychiques qu’on a les meilleures chances de les traiter, que ces sources soient fantasmatiques ou réelles. Et puis, il y a la vérité des professionnels socio-éducatifs, qui, eux, partent de l’ici et du maintenant des difficultés rencontrées, pour trouver avec la personne les moyens de s’en sortir. Pour eux aussi, la vérité de ce qui est vécu appartient à chacun et n’est guère objectivable. Comment, par exemple, traiter de la jalousie au sein d’une fratrie ? On sait bien en tout cas, que ce n’est pas en rationalisant et en démontrant qu’elle n’a pas lieu d’être. De même, arrive-t-il fréquemment d’être confronté à une personne que tous les malheurs accablent et qui présente une étonnante capacité de résistance. Son voisin quant à lui semble se noyer dans un verre d’eau et s’effondrer face au premier obstacle. Les travailleurs sociaux ont acquis l’habitude de dispenser leur action sans juger de la validité ou non de la souffrance éprouvée, ni d’en jauger la légitimité. Ce que résume très bien Francis Mahé, président d’honneur de l’AFIREM, qui affirmait en 1999, à propos des victimes d’agression sexuelle : « Qu’est-ce que cela veut dire quand un travailleur social dit à un enfant : ‘’je te crois’’ Cela veut dire adhérer sans preuves. Certes il n’a pas besoin de preuves puisque ce n’est pas son job. Si la procédure se met en route, il y aura des gens qui vont chercher des preuves et qui peuvent disqualifier le’’je te crois’’. Je préfère ‘’je t’ai entendu, ce que tu me dis est d’une importance considérable pour toi, je sais que tu souffres. D’autres personnes vont être chargées de chercher des preuves. Si elles n’en trouvent pas, cela ne voudra pas dire que rien ne s’est passé. Je serai quant à moi toujours là pour t’accueillir.’’ Je crois que c’est beaucoup plus sain de dire cela à un môme que de dire ‘’je te crois’’. » Cette réflexion de Francis Mahé prend une dimension particulièrement forte avec le procès d’Outreau. Il est temps à présent de tenter de répondre à la question : allons-nous devoir modifier notre comportement face aux révélations des enfants victimes ?
On pourrait affirmer de façon provocante : ni plus ni moins qu’avant. Les services judiciaires qui ont commencé depuis quelques années déjà à former et à spécialiser leurs équipes d’enquêteurs dans l’audition des mineurs doivent continuer dans cette voie pour toujours mieux affiner leur travail et éviter les dérives catastrophiques d’Outreau. Il s’agit pour eux non de se mettre à douter de la parole de l’enfant mais de toujours mieux la traiter. Les services sociaux ont, de leur côté, pour obligation de se soumettre aux contraintes légales de la loi de 1989, en signalant à l’autorité administrative ou judiciaire toute situation de maltraitance [lire le point de vue de Claude Bybau, psychologue]. Mais cette procédure ne doit pas venir geler ce qui constitue l’essence même des professions d’aide : donner du sens. Les travailleurs sociaux et les psychologues usent et abusent de l’interprétation des passages à l’acte et des comportements. Tel enfant est particulièrement perturbé ces temps-ci : n’est-ce pas en rapport avec sa dernière visite chez ses parents qui se serait mal passée ? Tel usager vient d’échouer une fois de plus à un essai professionnel : n’est-ce pas la conséquence de la névrose d’échec qui le poursuit depuis des années ? Tel parent ne s’est pas rendu à la rencontre avec les enseignants : n’est-ce pas en continuité avec la phobie scolaire qu’il a connue quand il était lui-même enfant ? Ces interprétations font le quotidien de nos professions. Ces hypothèses sont parfois fécondes. À d’autres moments, elles tombent complètement à côté. Mais, peu importe, elles constituent un outil utile. Il est pourtant une circonstance où cette méthodologie bloque : c’est lorsqu’un enfant ou un adolescent révèle une agression dont il est victime. Là, ce n’est jamais pour dire autre chose que ce qu’il dit. Il n’y a plus de place pour la moindre tentative de compréhension du sens caché : seul compte la procédure judiciaire. Quand un (e) jeune s’oppose avec véhémence à un adulte, on sait que la plupart du temps ce n’est pas lui qui est visé mais le cadre et les limites dont il est porteur. Il le fait aussi pour essayer de le déstabiliser ou vérifier sa solidité. Tout cela est connu : on sait bien que c’est une des façons de se construire. Mais quand il (elle) évoque un attouchement, il n’y a jamais de second degré : cela veut dire qu’il y a forcément eu attouchement. Agathe, une adolescente de 14 ans qui est fréquemment dans l’affabulation, révèle qu’à l’occasion d’un transfert, ses éducateurs ont utilisé son argent de poche pour acheter de l’alcool et s’enivrer toute la nuit. Personne ne la croit. Quelques mois plus tard, elle révèle être victime d’attouchements sexuels de la part de son père ? Là, elle dit forcément la vérité : garde à vue de 48 heures du père. L’affaire sera classée sans suite. Dans le premier cas, on a su interpréter son affabulation : il s’agissait de mettre en conflit ses parents, malades stabilisés de l’alcool et l’équipe éducative. Dans le second cas, ce n’est que bien plus tard qu’on a peut-être compris le sens de cette révélation : à cette occasion, sa mère a révélé l’agression sexuelle dont elle avait été, elle-même, victime de la part de son propre père et qu’elle cachait depuis des années. Agathe, en dénonçant son père, n’a-t-elle pas voulu faire éclater le secret de famille qui étouffait sa mère ? Au prétexte que pendant des années on cherchait surtout à interpréter la révélation de l’enfant comme produit de ses fantasmes, aujourd’hui, on s’interdit de lui attribuer tout sens. Les professionnels de l’aide doivent réhabiliter leur capacité de compréhension qui semble s’être congelée ces dernières années dès qu’on aborde la question des agressions faites à l’enfant. L’obligation de signalement ne doit pas paralyser leurs compétences d’analyses. Ils doivent les redéployer avec audace et circonspection entre le Charybde de la réduction exclusive des révélations de l’enfant à des messages cachés et le Scylla de leur traitement au pied de la lettre. C’est l’un des enseignements que l’on peut tirer du procès d’Outreau.
Jacques Trémintin
 L'enfant cassé. L'inceste et la Pédophilie
L'enfant cassé. L'inceste et la Pédophilie
Catherine Bonnet, éd. Albin Michel, 1999.
Catherine Bonnet est une psychothérapeute compétente qui sait de quoi elle parle. Son livre démontre un savoir-faire certain dans la prise en charge des enfants victimes de violence notamment sexuelle. Elle opère les distinctions adéquates entre l’agression sous terreur et celle qui organise la confusion entre le désir de tendresse de l’enfant et l’assouvissement du besoin sexuel du pédophile. Elle intègre bien l’imbroglio psychique qui s’empare de l’enfant quand violence et plaisir s’associent : et il est vrai que l’attouchement des zones érogènes est aussi source de plaisir, même si ce sentiment s’accompagne alors d’une honte indicible. On ne peut que constater la pertinence de son approche de la pulsion pédophile qui ne se traduit pas toujours en passage à l’acte : « Des adultes peuvent être traversés par des pensées violentes, infanticides, pédérastes ou incestueuses à l’égard de leurs propres enfants ou d’autres enfants. Il n’est pas rare que des parents ressentent une brève attirance pour le corps de leur enfant ou de leur adolescent. Mais la majorité des adultes contiennent ce type de pensée car ils ont intériorisé les interdits de la société et de la citoyenneté » (p. 238). Tout cela fleure bon l’intelligence, la pertinence et la clairvoyance. Pourquoi donc l’auteur s’est-elle alors engagée dans une galère qui ressemble à un cul-de-sac ? C’est que Catherine Bonnet ne nous fait ni plus ni moins que le coup du complot. Renouant avec la vieille tradition dualiste et manichéenne, elle divise l’univers en deux camps : les bons et les méchants. Du côté des premiers, il y a bien entendu ceux qui s’engagent dans la défense de l’enfance en danger, sans fioriture, sans hésitation, sans aucun questionnement. Et puis, du mauvais côté, l’on trouve les pervers ainsi que ceux qui sous prétexte de s’interroger sont en fait leurs otages. Se penche-t-on sur la suggestibilité de l’enfant ? Se demande-t-on si dans certaines situations, comme c’est par exemple le cas des divorces particulièrement agressifs et haineux, la dénonciation d’abus sexuel ne serait pas utilisée par l’une des parties pour se venger de l’autre ? Fait-on référence au syndrome des faux souvenirs qui a montré aux USA les ravages qu’ils pouvaient provoquer ? S’interroge-t-on sur l’efficacité d’un traitement psychothérapeutique systématique, un tel acharnement donnant parfois plus de mauvais résultats que de bons ? C’est là la preuve de l’offensive d’un « courant pro-agresseur » qui « influence insidieusement de nombreux professionnels en contact avec les enfants » et qui se fixe pour objectif de faire « à nouveau régner le temps des enfants menteurs et vicieux » (p.242). Sans opposer le moindre argument sérieux, l’auteur amalgame l’ensemble de ces questionnements dans une diabolisation qui frise l’excommunication. Malheureusement, ce genre de pratique n’a jamais permis de faire avancer la réflexion. Dommage !