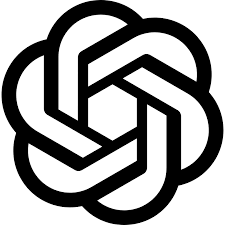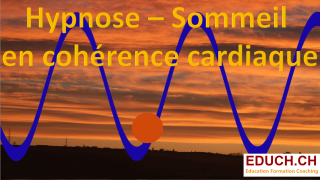Les durs lendemains du burnout
Brûlés
Des employeurs refusent de les embaucher malgré leur CV exemplaire. D’autres les congédient cavalièrement. Des collègues les répudient. Qui sont-ils? Les victimes du burnout, qui doivent souvent se méfier de patrons mécontents, d’assureurs suspicieux et de médecins complaisants. Comme quoi malgré les discours indulgents, un travailleur «brûlé» peut l’être sur tous les plans professionnellement.
Recherche et rédaction : Marie-Hélène Proulx
Photos : Luc Lavergne

Vous êtes un employeur à la recherche du bon candidat pour pourvoir à un poste de cadre. Sur les rangs, deux présentent un CV impressionnant et des compétences égales, à une seule différence près : l’un d’eux a déjà fait un burnout ou une dépression (voir définitions en encadré), épisode qui l’a forcé à s’absenter du travail pendant un moment. Cela influencera-t-il votre choix?
Jérôme, propriétaire d’une entreprise de génie-conseil, hésite, mal à l’aise face à cette question embarrassante. «Ça ne se dit pas, mais je vais privilégier celui qui n’en a jamais fait, parce que je crains que l’autre rechute. L’absentéisme, ça coûte cher! C’est bête, mais le but ultime d’une entreprise est de faire de l’argent.»
Même réaction de la part de Maxime, qui dirige une boîte de design industriel. «J’hésiterais à embaucher le candidat qui a fait un burnout parce que ses problèmes peuvent devenir lourds à gérer. J’aurais peur qu’il draine l’énergie de ses collègues et qu’il ne sache pas doser ses efforts.»
Sandra, conseillère en ressources humaines dans une entreprise de jeux vidéo, aurait pris la même décision. Tout comme Marie-Louise, gestionnaire dans une société financière. Avec une nuance, toutefois. «Si le burnout du candidat remonte à plus d’un an et qu’il n’a jamais fait de rechute, j’en fais moins de cas. Si c’est récent, je me tourne vers d’autres postulants, parce que je doute que la personne soit vraiment guérie et capable de faire face au stress et aux surcharges de travail ponctuelles.»
Ce genre de discours, Estelle Laflamme l’a entendu à satiété de la part d’employeurs. Directrice de l’agence de placement Groupe Athena, elle le dit sans ambages : «Il faut travailler deux fois plus fort pour convaincre les gestionnaires de rencontrer un candidat ayant déjà vécu des problèmes de santé psychologique. D’emblée, la plupart se montrent réticents. Certains refusent catégoriquement de les recevoir en entrevue.»
«C’est triste, mais un épisode de burnout peut nuire à la carrière d’un individu, estime aussi Karine, directrice d’une importante agence de placement à Montréal. Surtout s’il a été absent du marché du travail pendant plus de deux ans. Beaucoup d’employeurs craignent que les travailleurs ne soient pas capables de s’adapter aux changements survenus pendant leur congé de maladie. Ainsi, leur candidature peut être éliminée, même s’ils ont bien performé en entrevue. Les gestionnaires invoquent des raisons bidon pour les rejeter. Mais on sait lire entre les lignes!»
Cette attitude de fermeture de la part des chefs d’entreprise était encore plus préoccupante il y a cinq ou six ans, estime toutefois Marie-Thérèse Dugré, psychologue et vice-présidente de Solareh, une firme offrant des services de réadaptation et de retour à l’emploi. «Certains employeurs songeaient même à administrer des tests pour dépister les candidats susceptibles de développer des problèmes de santé mentale. Heureusement, ça ne s’est pas fait. Il faut dire que le regard des gestionnaires a changé par rapport au burnout, puisqu’eux aussi en font et consultent!»
Payer le prix
Si certains peinent à se placer les pieds dans une entreprise après s’être relevés d’un épuisement professionnel, ceux qui réintègrent leur poste au retour d’un congé de maladie n’ont pas la partie plus facile – du moins dans certains cas.
À la Commission des normes du travail, la responsable des relations de presse, Nathalie Bégin, confirme que de nombreuses plaintes concernent les congédiements, les suspensions et la discrimination d’un salarié à la suite d’une absence pour maladie ou accident d’ordre physique ou psychologique – 1 068 plaintes traitées au cours de l’exercice 2004-2005 sur un total de 2 083.
Jennifer a justement remporté sa cause en juin de cette année devant la Commission des normes du travail. L’affaire s’est finalement soldée par un règlement «à l’amiable» avec son employeur – elle a quitté l’entreprise avec une généreuse indemnisation en poche –, mais elle garde un souvenir amer de cette aventure.
— Louise Fréchette
Psychologue
«J’étais en congé de maladie pour dépression depuis un mois quand j’ai vu mon propre poste de superviseur de la comptabilité annoncé dans le journal local! raconte-t-elle, encore outrée. Ça faisait 17 ans que je travaillais pour cette compagnie de transports. Peu de temps après, j’ai reçu une lettre m’apprenant que je pourrais revenir, à condition d’accepter un poste à 12 000 $ de moins par année.»
Jennifer est convaincue qu’elle a été rétrogradée parce que la dirigeante de la compagnie n’a pas digéré son départ en congé de maladie, le second en deux ans (elle avait dû être opérée en 2004 pour un double pontage). «Quand je l’ai informée que je faisais une dépression et que le médecin m’avait mise en congé, elle m’a fait une scène terrible. Ensuite, elle a tout fait pour retarder les procédures administratives relatives à mon arrêt de travail.»
«Certains milieux sont difficiles à réintégrer à la suite d’un burnout, constate Claude Charbonneau, directeur général de la Fondation travail et santé mentale. On peut être carrément barré de l’entreprise. C’est vrai pour les employeurs très axés sur la productivité ou sur l’image que l’entreprise projette. Je pense notamment au cas d’une procureure de la Couronne qui n’a pas repris son poste à la suite d’une dépression sévère. Ses employeurs s’étaient montrés réticents à l’idée de la réintégrer parce qu’ils avaient perdu confiance en sa capacité de performer. Finalement, elle a décidé de se réorienter afin de vivre moins de pression.» Pas évident non plus pour les hauts dirigeants, qui peuvent voir leur leadership compromis après une dépression, estime Claude Charbonneau. Comme si la maladie leur faisait perdre leur aura de puissance. «J’ai vu un chef jadis respecté se faire demander s’il avait pris ses médicaments après qu’il ait levé le ton en réunion!»
En pratique privée, la psychologue Louise Fréchette constate aussi que des patients fraîchement rétablis d’un épuisement professionnel sont parfois ostracisés à leur retour au boulot. «Les gestionnaires modifient leurs tâches sans leur consentement, les ignorent ou leur font des remarques insidieuses et culpabilisantes, du genre : “Tu ne fonctionnes pas aussi bien qu’avant…” Ces actes visent à les écœurer suffisamment pour qu’ils finissent par quitter leur emploi.»
Jean Dussault, conseiller au service de santé et sécurité au travail pour la FTQ, a souvent observé ce phénomène. «Certains gestionnaires pratiquent l’ostracisme envers ceux qui ont fait un burnout, en partie pour des raisons d’efficacité. Ils préfèrent valoriser ceux qui travaillent comme des fous plutôt que de ménager les gens en baissant leur degré d’exigence. La priorité, c’est l’argent.»
Dans certaines entreprises, si on a déjà craqué, vaut mieux faire une croix sur les espoirs d’avancement. «Si l’employeur sait que le travailleur a été en congé de maladie pour une longue période à cause d’un problème psychologique», c’est sûr qu’il ne sera pas le premier sur la liste des promotions, remarque Claudine Ducharme, chef de la stratégie nationale, Santé et productivité à la Société Watson Wyatt Canada, un cabinet-conseil international spécialisé en capital humain et en gestion financière.
Un mal mystérieux
Les spécialistes s’entendent pour dire que la méconnaissance de la maladie mentale est à l’origine de bien des actes de discrimination à l’égard des rescapés du burnout. «Il est encore tabou de parler de santé psychologique», dit Nathalie Houlfort, psychologue et professeure-chercheure spécialisée en comportement organisationnel à l’École nationale d’administration publique. «On l’associe à la folie. Ceux qui ont des problèmes de cet ordre sont perçus comme des personnes fragiles, incapables de s’organiser ou de gérer leur stress.»
«Tous les collègues se cotisent pour acheter des fleurs et envoyer une carte à une victime d’un infarctus, ajoute Claude Charbonneau. Il a droit à du soutien, et quand il revient au boulot, tout le monde va le voir. Ceux qui partent en congé à cause d’une dépression n’ont pas droit au même traitement. Les gens sont mal à l’aise et ne savent pas comment aborder la personne.»
«Quand j’ai fait une dépression, personne ne m’a témoigné la moindre sympathie, se rappelle Marthe, secrétaire de direction dans un hôpital. C’est comme si tout le monde se foutait de moi.»
Pourquoi ce silence inconfortable? «On a peu démystifié les maladies mentales jusqu’à présent, contrairement au sida et au cancer, explique le Dr Rémi Quirion, directeur scientifique de l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies. On ne sait pas trop ce que c’est et ça nous fait peur. On commence à peine à parler de la maladie mentale ouvertement, comme l’a fait Margaret Trudeau récemment.» L’ex-épouse de Pierre Elliott Trudeau, mère de Justin et de Sacha, a parlé publiquement il y a quelques mois de la dépression bipolaire qui l’afflige depuis les années 1970.
Le fait que les signes du burnout ou de la dépression ne soient pas toujours évidents rend la compréhension de la maladie encore plus difficile. «Les problèmes de santé sans symptômes aussi patents qu’une jambe cassée ou qu’un cancer sont davantage susceptibles d’éveiller les soupçons des autres», affirme Louise Saint-Arnaud, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’intégration professionnelle et l’environnement psychosocial de travail.
«Quand j’ai fait une dépression, mon employeur m’a rappelé au bout de deux mois afin que je rencontre son propre médecin, raconte encore Marthe. Ça m’a humiliée, parce que j’ai eu l’impression qu’on ne me croyait pas. J’étais à bout et en plus, il fallait que j’aille leur montrer que j’étais réellement malade!»
Effet pervers
Aussi, quand on croise un collègue en congé de maladie au cinéma, au restaurant ou au centre commercial, le doute s’installe. Et si c’était de la comédie, ce présumé burnout? «On entend parfois ce genre de remarque dans les milieux de travail. Parce que les symptômes sont abstraits, on pense que les gens abusent du système. Pourtant, ça fait partie de la thérapie de sortir de la maison!» note Claudine Ducharme, de Watson Wyatt.
Pour Angelo Soares, professeur au Département d’organisation et ressources humaines de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, cette hostilité de la part des collègues s’explique de plusieurs façons. «Si le patron n’a pas remplacé la personne en congé de maladie, les coéquipiers sont obligés de se partager ses dossiers, en plus de faire les leurs. Ainsi, le malade devient la source de leur malheur. Cela crée de l’animosité.»
«Mais il y a plus, poursuit-il. La personne qui fait un burnout est la preuve vivante que le travail peut nous rendre malade. Or, cette réalité est si difficile à envisager que les travailleurs préfèrent se cacher derrière des mécanismes de défense tels que la négation. Ils se disent : “De toute façon, cette fille est une paresseuse”, ou alors “Elle avait trop d’activités en dehors du travail.” Certains minimisent aussi le problème en disant : “Elle exagère son mal.” En fait, ils trouvent plein de raisons pour blâmer la victime plutôt que l’organisation. Car s’ils pointent du doigt l’organisation, cela équivaut à s’avouer qu’ils peuvent tomber eux aussi.»
— Angelo Soares, UQAM
Or, le travailleur qui souffre d’épuisement professionnel est sensible au jugement de son environnement. «Lui-même ressent de la honte vis-à-vis de sa maladie, remarque la psychologue Louise Fréchette. Personne n’aime se heurter à ses propres limites. C’est dévalorisant. Surtout dans une société qui tolère difficilement qu’on ne puisse plus livrer la marchandise.» «Tous les patients en dépression que je rencontre craignent le retour au travail, note la psychologue Nathalie Houlfort. Ils ont peur de ne plus retrouver leurs capacités et s’inquiètent des rumeurs qui circulent à leur sujet au bureau. Malheureusement, ils ont parfois raison de s’en faire, car il arrive qu’on leur retire des responsabilités sans les consulter, parce qu’on les croit, à tort, moins performants qu’avant.»
Tout ça a pour effet de réduire les travailleurs au silence, même au plus fort de leur détresse. Selon une enquête menée en 2002 pour le compte de la Fondation des maladies mentales du Québec, 40 % des 600 Québécois sondés ont affirmé qu’ils ne souffleraient mot à leur employeur s’ils étaient atteints d’une dépression.
«Les gens ont peur que l’aveu d’un problème de santé mentale mette un frein à leur carrière, affirme Lola Noël, directrice des communications à la Fondation des maladies mentales. C’est une grave erreur. Plus on se prend en main rapidement, plus on a de chances de guérir en peu de temps, sans risque de rechute. Plus on attend, plus on s’enfonce, et plus c’est difficile de s’en sortir.»
Mettre ses culottes
Hélas, malgré une meilleure ouverture des entreprises vis-à-vis des problèmes de santé mentale depuis quelques années, peu d’entre elles aident les employés à briser le silence en adoptant, par exemple, des mesures proactives pour mieux comprendre le phénomène.
C’est du moins ce que soutient Claudine Ducharme, qui supervise chaque année l’enquête Au travail! de la firme Watson Wyatt. «En 2005, on a interrogé 94 entreprises canadiennes, qui emploient un total de 300 000 personnes. Seulement 5 % ont affirmé qu’elles allaient tenter de contrer les préjugés qui entourent la santé mentale. Quand on pense que d’ici 2020, la dépression sera la première cause d’invalidité dans le monde – selon l’Organisation mondiale de la Santé –, il y a de quoi s’inquiéter.»
L’ennui, c’est que les entreprises se sentent plus ou moins concernées par le problème, remarque la psychologue Louise Fréchette. «Quand le fusible d’un employé saute, les milieux de travail traitent cela comme un problème individuel, et non systémique. La personne finit par croire qu’elle est dysfonctionnelle, alors que c’est souvent son organisation qui l’est. Ça fait des années qu’on exigeait d’elle qu’elle tourne à plein régime, bien au-delà de ce qu’elle pouvait fournir. Et quand elle craque, c’est elle qui porte l’odieux de la situation.»
Angelo Soares partage cet avis. «Bien peu de compagnies modifient en profondeur leur manière de fonctionner quand les employés tombent comme des mouches. Certains partent en burnout et reviennent au bout de six mois. Sauf que rien n’a changé. La charge de travail est la même, il y a toujours aussi peu de reconnaissance, aussi peu d’autonomie et autant d’injustice. Résultat : les gens font un autre burnout au bout de quelque temps. Et on les congédie en leur disant qu’ils ne sont pas capables de faire le travail!»
Cela dit, ce n’est pas entièrement la faute aux entreprises si tant de gens pètent les plombs. «L’individu est largement en cause, pense Marie-Louise, gestionnaire dans une entreprise financière. Fait-on vraiment le job qui nous convient? Est-on à sa place dans tel type d’organisation? En 30 ans de carrière, je n’ai jamais vu quelqu’un qui aime son boulot faire un burnout, même s’il travaille 70 heures par semaine.»
La vie privée charrie aussi son lot de vicissitudes qui nous tirent vers le bas. Un enfant délinquant, un mari qui nous quitte, une mère malade qui agonise, et nous voilà anéanti. Quoi qu’il en soit, selon la chercheuse Louise Saint-Arnaud, les organisations demeurent en grande partie responsables de la détresse psychologique des gens. Chiffres à l’appui.
«Dans les études que j’ai menées depuis 10 ans, je demande toujours aux participants de m’indiquer la cause principale de leur arrêt de travail. Dans 30 % des cas, on me dit que c’est le travail; 60 % mentionnent le travail et la vie personnelle; et 10 % affirment que leur vie personnelle est au cœur de leur problème.»
Autrement dit, dans la presque totalité des cas, le boulot fait partie du bobo. «Nos conditions de travail ont connu une transformation sans précédent depuis 10 ans. La tâche s’est intensifiée et complexifiée – on doit maîtriser plusieurs technologies très rapidement –, et elle s’est précarisée, puisqu’on ne sait plus combien de temps on conservera son emploi.»
Ce qui n’est pas sans effet sur la santé mentale des gens. «Une des causes de l’épuisement professionnel est la perte de sens au travail, poursuit Louise Saint-Arnaud. À force d’accélérer la vitesse de croisière parce que la direction l’exige, les travailleurs finissent par couper dans la qualité du produit. Or, ce sacrifice fait souffrir ceux qui se soucient du travail bien fait. La qualité faisait partie de leur code d’éthique. Heureusement, la nouvelle génération est très préoccupée par la question du sens au travail. La raréfaction de la main-d’œuvre obligera peut-être les entreprises à revoir leurs valeurs et à réintégrer la notion de “sens”, en favorisant des liens plus étroits entre superviseurs et employés et en réduisant la charge de travail, par exemple.»
Moins de travailleurs à qui des employeurs exigeraient moins d’efforts? C’est la quadrature du cercle…
Il y a peu de chances que vous soyez indemnisé par votre assurance collective ou la CSST si vous présentez un certificat médical attestant que vous souffrez d’un «burnout» ou d’un «épuisement professionnel». Ces termes sont largement employés dans la vie courante, mais ils ne figurent pas dans le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de l’American Psychiatric Association, une bible en matière de maladie mentale. Autrement dit, il ne s’agit pas de maladies officiellement reconnues. C’est pourquoi on vous parlera davantage de «troubles d’adaptation avec humeur anxieuse ou dépressive», par exemple, ou carrément de «dépression».
Mais au fait, quelle est la différence entre les deux? Selon l’Ordre des
psychologues du Québec, la principale différence est que le burnout
(ou trouble de l’adaptation) est un épuisement lié plus spécifiquement au
travail, qui survient après un investissement professionnel excessif. Vous
n’êtes pas complètement à terre, mais assez perturbé pour avoir du mal à
fonctionner (grande fatigue physique et mentale, anxiété, insomnie, difficulté
de concentration, sentiment d’incapacité, colère et cynisme face au travail).
La personne parvient généralement à récupérer en se retirant de son milieu de
travail et en modifiant les attitudes et habitudes qui l’ont conduite à
l’épuisement. Or, une dépression, c’est la totale : vous n’êtes plus capable
de gérer quoi que ce soit dans votre existence. Vous vous êtes vidé de toutes
vos ressources, et plus rien ne vous fait envie. Cet état n’est cependant pas
nécessairement lié à votre emploi du temps.
(M.-H. P.)
Faut-il révéler à un employeur potentiel qu’on a déjà fait un burnout ou une dépression? Dilemme cornélien! Chose certaine, vaut mieux bien choisir ses mots quand on décide de dire la vérité.
| Pub. |
Un voyage en Afrique pendant un an, une histoire familiale à régler, une année sabbatique pour se ressourcer; autant de prétextes qu’on peut servir à un employeur potentiel pour camoufler son absence du marché du travail pour cause de burnout. Quand on sait que la vérité peut anéantir ses chances d’obtenir l’emploi, la tentation est forte de se la boucler.
«C’est une situation délicate, convient Nathalie Houlfort, psychologue et professeure-chercheure à l’École nationale d’administration publique. Dire qu’on a été absent du marché du travail pendant un an en raison d’un burnout peut éveiller des craintes chez l’employeur. D’un autre côté, est-ce une bonne chose de mentir?»
Au cours des entrevues de sélection de personnel qu’elle a menées, l’universitaire a constaté que les travailleurs qui admettaient avoir déjà souffert d’un problème de santé mentale connaissaient mieux leurs forces et leurs limites, ce qui est très positif en milieu de travail. «Mais pour le comprendre, il faut un employeur ouvert d’esprit, ce qui n’est pas toujours le cas.»
Les travailleurs n’ont pas à répondre à des questions concernant leur santé en entrevue d’embauche, rappelle Richard Sylvestre, agent d’information à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. «Autrement, c’est de la discrimination fondée sur le handicap.»
Avec un grand V
Malgré tout, le directeur de la Fondation travail et santé mentale,
Claude Charbonneau, encourage les gens à adopter la stratégie avec
laquelle ils sont vraiment à l’aise. Pour Jennifer, qui s’apprête à
réintégrer le marché du travail après un congé de maladie de neuf mois,
ce sera sans contredit la vérité avec un grand V! «J’ai trop peur que mes
nouveaux patrons apprennent par l’entremise de quelqu’un d’autre que j’ai
fait une dépression. Aussi bien être honnête. Sinon, ça va me stresser.»
«Certaines personnes détestent cacher des aspects de leur vie, explique la psychologue Louise Fréchette. Ce n’est pas mauvais, pour autant qu’ils ne présentent pas leur burnout comme étant l’événement le plus honteux de leur existence. Il faut expliquer les circonstances et préciser que ça a été pour soi l’occasion de faire des changements heureux dans sa vie. En somme, dire qu’on est mieux équipé que jamais pour faire face aux enjeux professionnels. Ça les rassurera. Mais si l’employeur n’aborde pas la question en entrevue, pourquoi faire un détour pour le dire?»
Un choix personnel
Marie-Louise, gestionnaire dans une société financière, a déjà embauché
des travailleurs qui avaient souffert de problèmes de santé mentale. Elle
prône le dialogue. «À mes yeux, les conséquences de l’omission sont pires
que celles de la vérité. Tout finit toujours par se savoir. Je suis
d’avis que de jouer franc jeu est la base d’une relation durable et
honnête entre patron et employé. De plus, sachant les causes qui ont
conduit l’employé à faire un burnout, un gestionnaire pourra
mieux orienter sa gestion en s’assurant, par exemple, que la personne a
une charge de travail équilibrée.»
Une philosophie à laquelle Paule n’adhère pas du tout. Cette réalisatrice n’en a soufflé mot à personne lorsqu’elle a fait un burnout. Elle a même préféré démissionner pour ne pas avoir à rendre des comptes à son patron, vivant grâce à ses REÉR jusqu’à ce qu’elle soit rétablie. Elle a maintenant réintégré ses fonctions.
«J’estime que cet épisode de ma vie ne regarde ni mes supérieurs ni mes collègues, dit-elle. J’avais besoin de me ressourcer, je suis partie, point à la ligne. Je travaille dans un milieu hyper stressant et je n’ai pas envie qu’on dise à mon sujet que je n’ai pas les nerfs pour faire mon travail parce que j’ai déjà fait un burnout. Ce genre de ragot peut être très dommageable.»
Quoi qu’il en soit, si une personne est mal à l’aise de mentir au sujet de son épuisement professionnel, mais qu’elle doute de sa capacité à se vendre à un employeur, elle peut toujours faire appel à une agence de placement. Les conseillers ont l’habitude de faire le marketing de leurs clients et sauront probablement faire ressortir les éléments positifs de cet épisode devant les gestionnaires. Mais ce sera tout de même au travailleur de vendre sa salade une fois l’entretien d’embauche obtenu.
Quant à la personne qui réintègre son ancien milieu de travail après
un congé de maladie, Nathalie Houlfort suggère de jouer la carte de la
transparence, sans hésiter. Avant son départ, la personne qui souffre a
pu se montrer irritable et peu productive, une attitude qui s’est
peut-être soldée par quelques pots cassés. «Ne vous enfermez pas dans
votre bureau, comme si vous étiez honteux, prévient-elle. Expliquez à vos
collègues la raison de votre absence. Sans verser dans les détails
personnels, dites que vous étiez anxieux et qu’il vous fallait du temps
pour gérer ça. Il est important aussi de mentionner que vous allez mieux
et que vous êtes prêt à reprendre le collier.»
(M.-H. P.)