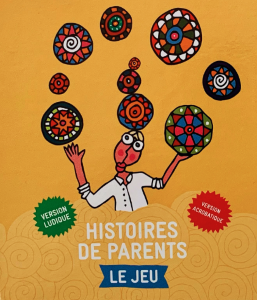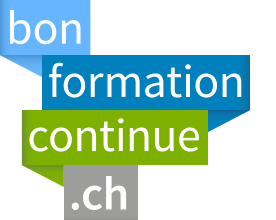Numéro 678, 18 septembre 2003
Pour un recueil respectueux de la parole de l’enfant
Un petit garçon est retrouvé couvert de brûlures de cigarettes. L’enfant déclare qu’il a été baillonné avec du sparadrap et que sa mère lui tenait les mains pendant que son père le punissait en lui brûlant le corps avec le bout de cigarettes allumées. Le juge des enfants refusera de voir là le résultat de mauvais traitements. Son argumentation ? « Ce n’est pas de la maltraitance, puisque c’est un acte isolé ». Quant à l’éducateur qui exerçait une mesure d’AEMO, il affirmera : « On connaît bien la famille, elle n’est pas capable d’avoir fait cela ». Il faudra la preuve de photos apportées au magistrat, pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’une crise d’eczéma comme le prétendent les parents. Ce récit terrible ne date pas « d’avant », de l’époque où l’on se contentait d’affirmer que les enfants mentaient beaucoup quand ils se plaignaient de recevoir des coups. Non, il a été rapporté par Geneviève Favre-Lanfray, docteur en droit et administrateur ad’hoc, lors des récentes journées d’Anthéa en mai 2003.
Le 19 mai 1998, Vincent Cottalorda, instituteur de son état, est interpellé par les gendarmes et mis en examen pour des faits de violence physique et d’agression sexuelle sur plusieurs enfants. Il est interdit de séjour dans son département. Le juge d’instruction saisi prend finalement une ordonnance de non-lieu, le 27 mars 2000, en s’appuyant notamment sur l’expertise qui décrit le témoignage d’un des jeunes témoins comme « rocambolesque » : « sur un plan strictement médico-légal l’abondance des violences physiques dénoncées par certains enfants contrastait avec l’absence de toute constatation légale » et « sur le plan psychologique, il existait une réunion de plusieurs enfants dont le champ de perception sexuelle était perturbé par des comportements familiaux et que le milieu délétère semblait être situé plus au niveau familial ou environnemental qu’au niveau scolaire. »
Ces deux exemples semblent diamétralement opposés. Le premier montre qu’il existe encore des circonstances où l’enfant n’est pas cru quand il révèle être victime de maltraitance. Le second montre que sa parole peut être parfois prise au pied de la lettre, quand il se plaint, sans précaution aucune, provoquant la mise en accusation d’un adulte qui sera relaxé. En réalité, ces deux situations partagent en commun le manque de discernement des professionnels tant médico-sociaux que judiciaires : entre la persistance d’une certaine forme de déni et la trop grande précipitation, la souffrance de l’enfant n’a pas été prise en compte, à sa juste mesure. Le résultat obtenu, c’est une victimisation secondaire : dans le premier cas, un enfant déjà martyrisé a subi les affres du doute et l’incrédulité de ceux qui étaient censés le protéger. Dans le second cas, un adulte a subi injustement l’infamie et le soupçon.
Certaines études font état de 50 à 80 % de victimes qui ne révèlent jamais ce qu’elles ont subi. Le poids du passé pèse encore sans doute beaucoup. Pendant très longtemps, les agressions que subissaient les enfants au sein des familles ont été banalisées, voire niées, le récit qui en était fait étant considéré comme pur mensonge. La prise de conscience qui a émergé dans les années 1980 a provoqué une mobilisation des médias et des milieux professionnels. La loi de 1989 a pénalisé la non-dénonciation de mauvais traitements, les dispositifs de prévention et de protection se sont affinés, les condamnations en justice se sont multipliées. On ose croire (sinon espérer) que les cas d’aveuglement quant à la maltraitance des mineurs se fassent toujours de plus en plus rares. Pour ce qui est des accusations non fondées en direction d’adultes qui, après enquête, s’avèrent juridiquement non coupables, on ne dispose pas de statistiques globales. Seuls existent les chiffres proposés en 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité. Cette association qui regroupe 718.000 adhérents parmi les personnels de l’enseignement public et laïc, aide les professionnels qui sont confrontés aux aléas de la vie professionnelle ou privée. Entre 1996-1997 et 2002, 486 dossiers lui ont été transmis concernant des affaires de mœurs. 201 d’entre eux n’étaient pas encore clos au moment où ces éléments ont été rendus publics. Parmi les 285 qui l’avaient été, 26 avaient donné lieu à une condamnation, 3 à un suicide, 165 avaient été classés sans suite et 43 s’étaient traduits par une relaxe. On peut faire dire aux chiffres tout ce que l’on veut. Ce n’est pas parce que sur les 208 dossiers clos, 73 % n’ont donné lieu à aucune condamnation judiciaire, que cela signifie forcément que les personnes mises en cause étaient innocentes. On connaît trop ces situations d’agression sexuelle où, faute de preuve ou parce que la parole de l’enfant s’oppose à la parole de l’adulte ou encore parce que la petite victime a fini par se rétracter, la justice ne peut pas trancher. Néanmoins, on conviendra qu’il y a, au moins, de quoi s’interroger. Que les adultes responsables d’atteintes inacceptables portées aux enfants soient poursuivis, stigmatisés et condamnés ne fera pleurer dans aucune chaumière. Mais quid des mises en cause qui se sont avérées erronées ? Peut-on se contenter de les comptabiliser dans les pertes et profits ?
La question qui se pose est bien de savoir si l’on dispose ou non des moyens pour essayer d’objectiver un tant soit peu les données livrées par un enfant qui fait une révélation. La première chose sur laquelle plusieurs études nous éclairent, ce sont ces biais qui peuvent contribuer à fausser le recueil des déclarations de l’enfant. Le premier d’entre eux tient dans la particularité même de l’enfance. L’être humain n’atteint sa pleine maturité que très tardivement. La longue période de l’enfance est marquée par des traits particuliers qu’on ne peut ignorer quand on a affaire à un jeune public. L’enfant n’a pas toujours confiance et peut se montrer réticent vis-à-vis d’un adulte qu’il ne connaît pas, surtout quand celui-ci va l’interroger sur les atrocités qu’il a subies. Cela peut gêner sa communication. Ses capacités linguistiques sont en outre, selon son âge, limitées. Il n’a pas vraiment l’habitude de demander à l’adulte de reformuler quand il n’a pas compris ce qu’il lui a dit. Il pourra répondre oui ou non à une question posée en des termes non adaptés à son âge, sans que cela corresponde vraiment à ce qu’il pense. Autre élément : sa mémoire est moins apte à gérer et à hiérarchiser à la fois les informations récentes et celles qui sont plus anciennes. Cette mémoire fonctionne plus encore que chez l’adulte, sur une logique de scénario : remémorer un événement revient à reconstituer un tout à partir d’éléments épars, selon une idée que l’on se fait dans le présent de ce qui a dû se dérouler dans le passé. Autre caractéristique importante : l’enfant est en position de dépendance à l’égard de l’adulte. Il peut être spontanément amené à se conformer à ce qu’il imagine être le désir de celui-ci et lui confirmer ce qu’il sent qu’il veut qu’il dise. Enfin, sa suggestibilité est forte : tout propos inducteur peut contaminer définitivement son récit. Ces limites cognitives et linguistiques que nous venons de souligner ne sont pas évoquées ici pour décrédibiliser la parole de l’enfant, mais pour souligner l’importance pour l’adulte d’adopter des attitudes très vigilantes : si sa bienveillance ainsi que sa profonde humanité sont indispensables, sa capacité d’observation et d’écoute attentives ainsi que sa proximité de l’univers et du mode de fonctionnement de l’enfant le sont tout autant. Ces comportements requis chez l’intervenant constituent le second biais auquel il faut porter une attention toute particulière. Plusieurs facteurs peuvent venir déstabiliser ses capacités d’évaluation. La dimension affective joue, en la matière, un rôle essentiel. Il n’est pas évident de gérer les difficultés d’ordre émotionnel qui peuvent assaillir l’intervenant confronté à l’horreur d’un enfant maltraité. La nécessité d’une stricte neutralité s’impose (qui n’interdit pas pour autant l’empathie, bien au contraire), l’enfant captant très facilement chez son interlocuteur les moindres attitudes de gène, d’angoisse, de rejet, de doute, de dégoût ou de désintérêt. Il n’est pas forcément plus facile de se décontaminer par rapport aux préjugés ou aux idées reçues qui sont particulièrement prégnants sur ces sujets douloureux. La plupart des adultes que nous sommes avons tendance à croire à ce que nous voulons ou à ce que nous avons besoin de croire. Plus nous adhérons à une théorie explicative, plus nous nous y attachons de façon indélébile. Chaque enfant réagit à sa façon, en fonction de ses propres mécanismes de défense, de ses ressources personnelles, de ses émotions et de ses sentiments : entre celui qui se renferme sur lui-même et celui qui raconte ce qui s’est passé exactement, en livrant tous les détails, il y a toute une palette de situations possibles, y compris des récits qui ont pu subir des déformations liées à des confusions, des symbolisations, des contaminations, voire dans des cas très exceptionnels, des mensonges. La difficulté tient pour beaucoup dans le fait que dans ce genre de situation, malheureusement, tout est possible. L’aspect en apparence peu crédible de ce qui est relaté n’est pas suffisant pour conclure qu’il est peu probable que cela ait eu lieu. Il faut donc faire preuve à la fois d’une grande ouverture d’esprit et de beaucoup de disponibilité. On doit envisager toutes les hypothèses possibles en ne privilégiant d’emblée aucune : ni celle d’un abus, ni celle d’un malentendu, d’une fabulation ou d’un mensonge même si, rappelons-le, cette dernière éventualité représente un très faible pourcentage de probabilité. La seule attitude professionnelle véritablement respectueuse de la parole de l’enfant consiste à essayer de comprendre le point de vue de la victime, plutôt que de vouloir à tout prix imposer, face à son vécu, le schéma explicatif dont on est convaincu. Tout cela demande une solide formation, une supervision et un équilibre personnel indispensable.
La parole ne sera pas forcément le seul support (ni le premier) utilisé par l’enfant. L’intensité du stress émotionnel qu’il a subi au cours de l’abus peut réduire fortement la possibilité qu’il puisse aborder ce qu’il a vécu par le biais d’une pensée structurée et surtout disponible. Mais, ce n’est pas parce que l’enfant ne dit rien qu’il n’a rien à dire. Il peut le dire d’une tout autre façon. C’est le rôle joué par les symptômes. L’enfant peut mettre en place des manifestations qu’il investit comme autant de systèmes de vigilance et de stratégies de survie. On a été tenté d’en établir une liste et de l’utiliser comme signal d’alerte. Toutefois, nombre de ces signes de mal-être ne sont pas spécifiques à une situation d’abus. Ils peuvent se produire en présence de bien d’autres circonstances. Ainsi, des fugues, des conduites régressives, du repli sur soi, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration de la mémoire ou du fonctionnement intellectuel qui ne constituent pas un signal particulier. Il en va de même pour les jeux sexuels spontanés. Une étude a démontré que sur une population de 200 enfants non abusés, 50 % de l’échantillon ont adopté des comportements sur des poupées sexuées qui pourraient faire croire à un abus antérieur. La prudence est donc de rigueur. La recherche s’est aussi tournée vers l’élaboration de critères fiables et rationnels pour analyser la parole de l’enfant. L’une des méthodes mises au point s’appelle « l’analyse de validité de la déclaration » [« Statement Validity Analysis » (S.V.A.)]. D’origine nord-américaine, elle est utilisée en Belgique par « Parole d’enfants » [1] au cours des expertises de crédibilité que lui confie la justice. Cette association, bien connue du public français pour les colloques qu’elle propose a animé en décembre 2002, une session de formation à cette technique [2]. Première précaution avant toute présentation c’est d’affirmer que cette méthode, pas plus qu’une autre, ne constitue une panacée. Ce n’est pas non plus un détecteur de mensonge. Elle permet juste d’envisager la probabilité de la véracité du récit recueilli. Elle est construite à partir de la conviction qui veut que ce qui a été vécu véritablement sera décrit différemment que ce qui aura été inventé. Une grille a donc été élaborée comportant 19 critères [voir encadré ci dessous]. Cette grille s’attache tout particulièrement à rechercher des éléments que l’on trouve plus rarement dans un récit construit artificiellement : la référence à des complications inattendues survenue au cours de l’abus (g) : un téléphone qui sonne, quelqu’un qui frappe à la porte… Il en va de même pour des détails inusités (h) : éléments étranges ou inhabituels décrits avec réalisme comme le port de chaussettes de couleurs différentes ou une particularité physique de l’agresseur ; mais aussi des détails périphériques (i) : éléments extérieurs à l’abus comme un bruit dans l’appartement voisin, un orage etc. Dans la même catégorie, on retiendra des détails non compris, mais rapportés de façon exacte (j) : l’enfant qui prend les gémissements de l’abuseur pour une souffrance ; mais aussi des incidents extérieurs (k) : propos tenus sur un sujet étranger à l’abus lui-même. Autre ressort : des facteurs qui pourraient apparaître au premier abord comme preuves de non fiabilité et constituant au contraire une preuve de haute crédibilité : les corrections spontanées (n) : l’enfant modifie son récit ; les aveux de blanc de mémoire (o) : l’enfant ne se souvient pas de certains détails ; les doutes à propos de sa propre déclaration (p) n’apparaissent quasiment jamais dans un récit fabriqué puisque son auteur cherche à lui donner la forme la plus parfaite et la moins hésitante possible. Ici, ils montrent une véritable authenticité, ce qui a été vécu ayant pu être mémorisé dans une certaine confusion. Certaines circonstances particulières dé-crites renforcent la crédibilité : la description précise des interactions, faits et gestes (e) ; le rappel des conversations tenues par l’abuseur (f) ; la référence à son propre état psychologique (l) : ce que l’enfant a ressenti au moment des faits ; ainsi qu’à l’état psychologique de l’abuseur (m). Les caractéristiques générales du récit sont aussi étudiées : sa cohérence globale (a), son déroulement spontané (b), les détails en quantité suffisante qu’on y trouve (c), ainsi que son enchâssement contextuel : le fait de le placer dans un contexte spatio-temporel (d). Selon la méthode SVA, plus un récit répond à ces critères (avec un minimum de 8) plus il a de chance d’être crédible. Encore faut-il que l’entretien se fasse le plus proche possible du témoignage initial et respecte des modalités du récit libre (l’enfant est invité à parler sans être dirigé par des questions trop précises), le moins inducteur possible (questions ouvertes et non suggestives) et respectueux de son rythme (en excluant toute pression et contrainte)…
Cette méthode n’est en aucun cas fiable à 100 %. Elle ne constitue aucune garantie. Elle permet de prendre de la distance avec sa propre subjectivité et sa propre émotion et d’apporter un certain nombre d’éléments d’objectivité. On mesure assez facilement l’exigence de qualification qu’implique l’utilisation d’une telle approche. Les services de police et de gendarmerie ont spécialisé des intervenants en leur apportant une formation adaptée. Il n’en va pas de même pour les travailleurs sociaux qui ont à gérer ce genre de situation bien moins fréquemment. Ne serait-il pas judicieux de concevoir des cellules médico-sociales spécialisées qui auraient pour fonction d’accueillir très rapidement les révélations des enfants en amont du signalement, permettant d’aider les professionnels aux prises avec les toutes premières paroles des victimes. Cela pourrait assurer un accompagnement efficace et bien moins traumatisant qu’il ne l’est parfois aujourd’hui. Mais, cela impliquerait, comme c’est le cas en Belgique, que la judiciarisation ne soit pas la première étape après la révélation, mais que les professionnels du social reprennent leur place, celle de l’évaluation des difficultés et de l’orientation la plus adéquate. Ce n’est pas ce que prévoit le dispositif actuel.
Jacques Trémintin
[1] « Parole d’Enfants » - 107 rue de Reuilly - 75012 Paris. Tél. 0 800 90 18 97. mail : parole@swing.be
[2] « L’investigation psychosociale dans les situations de suspicion d’abus sexuels »
L’analyse de validité de la déclaration
(Statement Validity Analysis)
I • Caractéristiques générales de la déclaration
a) Cohérence (consistance interne, tenue globale du récit)
b) Verbalisations spontanées (propos surgissant de façon désordonnée et non pré-construit)
c) Détails en quantité suffisante (quantité d’éléments apportés)
II • Contenus spécifiques de la déclaration
d) L’enchâssement contextuel (contexte spatio-temporel du récit)
e) Description d’interactions (relation des gestes posés par l’abuseur et la victime)
f) Rappel des conversations (relation des dialogues entre l’abuseur et la victime)
g) Référence à des complications inattendues (événements survenus qui ont compliqué l’action de l’abuseur)
III • Particularités du contenu
h) Détails inusités (éléments étranges et inhabituels)
i) Détails périphériques (éléments extérieurs à l’abus)
j) Détails non compris, mais rapportés de façon exacte (l’enfant ne comprend pas certains éléments mais les décrit fidèlement)
k) Référence à des incidents extérieurs (éléments extérieurs à l’abus évoqués par l’abuseur)
l) Référence à ses propres états psychologiques (l’enfant décrit ce qu’il a ressenti au moment de l’abus)
m) Attribution d’un état psychologique à l’abuseur (l’enfant décrit ce qu’il a perçu de l’état et des ressentis de l’abuseur)
n) Corrections spontanées (l’enfant modifie son récit)
o) Aveu de blancs de mémoire (l’enfant ignore certains détails)
p) Doutes à propos de sa propre déclaration (l’enfant n’est plus sûr de certains détails)
q) Désapprobation de sa propre participation (l’enfant émet une certaine culpabilité)
r) Le fait d’excuser l’abuseur (l’enfant trouve des raisons à l’abuseur)
IV • Éléments spécifiques concernant le délit
s) Caractéristiques spécifiques du délit (l’enfant décrit une chronologie déjà répertoriée)