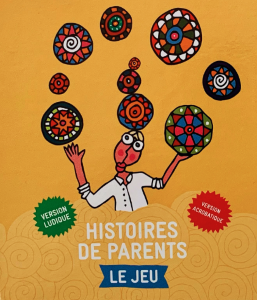|
Formation thérapeutique
La schizophrénie
La schizophrénie associe une dissociation de la pensée et des affects, un
délire plus ou moins constant qu’accompagnent des troubles cognitifs et un
repli sur soi. Cette altération importante de la personnalité a un
retentissement affectif et social préoccupant. Toutefois, une prise en charge
globale, ne pouvant se limiter à la prescription de psychotropes, permet
souvent de maintenir une relative socialisation du patient schizophrène.
Les mots du client

La prise en charge globale doit permettre le maintien de la socialisation
du patient schizophrène (Phanie)
– Mon fils, Stéphane, s’enferme très souvent dans sa chambre, parfois tout
le week-end ; il n’a plus d’amis et rumine des idées bizarres sur la venue
prochaine de Dieu.
– Mon frère revient d’une hospitalisation en psychiatrie. Son traitement
lui réussit mal et il fait des mouvements saccadés involontaires…
– Ma fille me semble vraiment devenue folle : elle entend une voix lui
raconter sa vie dès qu’elle allume le téléviseur.
Rappel physiopathologique
La prévalence de la schizophrénie au cours de la vie varie, globalement, de
0,09 à 1,1 à l’échelle de la planète. Son incidence est comprise entre 0,02 %
et 0,06 % selon les études, tandis que le sex-ratio de la maladie est
quasiment identique dans les deux sexes. Les origines de la schizophrénie
restent méconnues. La participation génétique à une dysrégulation de la
neurotransmission cérébrale, essentiellement au niveau dopaminergique
(hyperactivité mésolimbique) et sérotoninergique, semble acquise, mais ne
représente pas à elle seule un facteur déclenchant. L’expression clinique de
la maladie implique des facteurs environnementaux mal connus (hypoxie foetale,
infection virale foetale, difficultés psychologiques ou sociofamiliales,
etc.).
Symptomatologie de la schizophrénie
Au plan de la clinique, la schizophrénie associe, à des degrés variables, des
modifications du cours de la pensée et des perceptions sensorielles, ainsi
qu’un émoussement des affects. Les capacités intellectuelles demeurent
préservées – du moins dans la phase initiale de la maladie. Son évolution
peut se faire vers une désagrégation totale de la personnalité du patient. La
schizophrénie associe plusieurs dimensions syndromiques expliquant sa
complexité clinique. La prééminence de tel ou tel syndrome permet de
caractériser les diverses présentations de la maladie : le syndrome
dissociatif, qui englobe toutes les dimensions (intellectuelle, affective,
comportementale) du psychisme ; les symptômes positifs (productifs), in-
constants souvent spectaculaires (hallucinations auditives ou visuelles,
illusions olfactives, etc.) ; les symptômes déficitaires (négatifs) se
traduisent par des troubles de l’humeur à type de dépression ; les troubles
cognitifs qui ne doivent pas être négligés afin de bénéficier d’un traitement
susceptible de les limiter.
Evolution de la schizophrénie
Le début de la phase clinique de la schizophrénie est décrit souvent chez un
adulte jeune (18-25 ans), mais parfois après 40 ans (même si alors le
diagnostic de délire chronique est plus fréquent !). Selon le cas, il se
traduit par une rupture insidieuse du comportement antérieur du sujet (repli
sur soi, apathie, absence de plaisir et d’initiatives, démotivation sociale,
instabilité psychoaffective, imprévisibilité du comportement, ano- rexie,
troubles phobiques divers, etc.) ou par une manifestation spectaculaire
réalisant un tableau de bouffée délirante, une dépression ou, rarement, une
catatonie (suspension de toute activité motrice avec mutisme total). La
schizophrénie évolue de façon variable, faisant alterner des phases de
rémission plus ou moins prolongées avec des épisodes productifs. Certains
patients présentent des formes peu évolutives dans le temps, alors que
d’autres seront sujets à une désagrégation rapide de leur personnalité avec
désocialisation importante.
Les rechutes, définies comme des récurrences de la schizophrénie chez des
patients ayant répondu au traitement, sont fréquentes puisque le risque est
estimé à 30-40 % pendant les cinq premières années de développement de la
maladie. Cela justifie, entre autres, l’intérêt d’un suivi très régulier des
patients schizophrènes en ambulatoire, souvent dans des centres de
consultations médico-psychologiques (CMP).
Quoi qu’il en soit, l’évolution de la schizophrénie impose des
hospitalisations plus ou moins récurrentes : l’un des enjeux du traitement
pharmacologique, et notam- ment le recours aux formes à libération prolongée,
est, précisément, de limiter la fréquence comme la durée des séjours
hospitaliers et de permettre la mise en place, puis la poursuite d’un projet
thérapeutique global.
La mortalité des patients schizophrènes est plus élevée que celle de la
population générale.
Chez le psychiatre
Un diagnostic de schizophrénie peut être suspecté chez un adolescent ou un
jeune adulte manifestant des comportements étranges, ces troubles constituant
une rupture dans son existence et évoluant sur plusieurs mois. Il s’agit
souvent d’une attitude de repli, centrée sur des préoccupations mystiques ou
ésotériques, psychologiques ou pseudo-scientifiques. Cet apragmatisme
s’accompagne d’un désinvestissement des activités scolaires, universitaires
ou professionnelles. Si l’entourage ne comprend pas la valeur de ces signes,
la maladie peut évoluer longtemps sans que le sujet ne soit vu par un
médecin. Toutefois, la schizophrénie peut être découverte à la suite d’un
épisode de bouffée délirante, sans signes annonciateurs, et justifier alors
une prise en charge immédiate. Une hospitalisation est indispensable pour
réaliser le bilan diagnostique, qui intègre l’histoire du patient
(antécédents psychiatriques, comportement général, antécédents de fugues, de
tentatives de suicide, conduites d’alcoolisation ou de prise de drogues,
etc.). Cette hospitalisation permet de repérer des signes dissociatifs
souvent frustes : suspension du cours de la pensée et de l’expression des
idées, « barrage » verbal (= brutale interruption du discours, puis reprise
sur un sujet non congruent), anomalies dans les associations de pensées,
difficultés de l’attention, suggestibilité ou négativisme, bizarreries
comportementales, etc. Le psychiatre élimine un état dépressif atypique, un
état maniaque, un trouble bipolaire avec illusions sensorielles, ou, tout
simplement, une « originalité » temporaire liée à une difficile quête
d’identité, situation fréquente à l’adolescence.
Les médicaments de la schizophrénie
La prise en charge du patient schizophrène intègre plusieurs dimensions
complémentaires et toutes également importantes : traitement pharmacologique,
accompagnement sociopsychologique, aide éducative. Le traitement
médicamenteux est centré sur l’administration d’antipsychotiques (idéalement
en monothérapie, mais, dans la pratique, deux ou trois en milieu
institutionnel…), auxquels sont associés éventuellement des correcteurs
d’effets indésirables, et souvent d’autres types de psychotropes
(anxiolytiques, antidépresseurs).
Antipsychotiques de première génération. L’intérêt
thérapeutique des antipsychotiques de première génération (Dipipéron, Haldol,
Largactil, Loxapac, Nozinan, Orap, Piportil, Tercian, etc.), commercialisés
dans les années 1950, fut longtemps considérable : ils permirent de proposer
des traitements actifs dans un domaine où la médecine était jusqu’alors
impuissante. Mais leur action sur les manifestations négatives de la
schizophrénie se révéla réduite et, surtout, ces médicaments furent à
l’origine d’effets indésirables neurologiques expliquant la mauvaise
observance du traitement. Une évaluation du risque cardiologique lié à
l’utilisation des antipsychotiques a conduit l’Afssaps à formuler des
recommandations en 2001 et à retirer du commerce le dropéridol (Droleptan),
qui constituait l’une des molécules les plus communément usitées pour réduire
l’agitation – comme l’avait été le sultopride (Barnétil) injectable en 1999,
et comme l’est cette année la forme orale de cette même molécule.
La commercialisation dans les années 1960 d’antipsychotiques d’action
prolongée (les NAP), administrés toutes les 2 à 4 semaines, a facilité la
prise en charge au long cours du patient schi- zophrène en améliorant
l’observance du traitement. Ces molécules estérifiées avec un acide gras
(exemple : décanoate d’halopéridol = Haldol Decanoas ou de zuclopenthixol =
Clopixol AP, décanoate de fluphénazine = Modécate), présentées sous la forme
de solutés ou de suspensions injectables réalisés dans un solvant huileux,
présentent plusieurs avantages : – stabilisation des taux plasmatiques ;
– suppression de l’effet de premier passage hépatique ;
– assurance d’une délivrance régulière du principe actif ;
– minimisation du risque toxi-que (erreur d’administration, tentative de
suicide) ;
– surtout, amélioration de la compliance au traitement.
Néanmoins, elles n’ont pas amélioré la question de la tolérance.
Antipsychotiques de deuxième génération. Les
antipsychotiques de deuxième génération, dits aussi « atypiques » (Abilify,
Leponex, Risperdal, Solian, Zyprexa), ont un profil pharmacologique que
caractérisent notam- ment :
– une action inhibitrice D2 expliquant l’efficacité sur les signes productifs
; – une action inhibitrice 5HT2 expliquant l’efficacité sur les signes
négatifs ;
– un respect de la transmission dopaminergique nigrostriée expliquant la
moindre incidence des effets extrapyramidaux aux posologies recommandées par
les AMM ;
– une action favorable sur les troubles cognitifs.
Ayant les mêmes indications que les antipsychotiques conventionnels, les
antipsychotiques de seconde génération se caractérisent par un profil
d’action plus global sur les composantes symptomatologiques de la psychose :
1) sur la symptomatologie positive ; 2) sur la symptomatologie négative ; 3)
sur le déficit cognitif.
Le profil de tolérance de ces molécules diffère de celui des
antipsychotiques conventionnels sur certains points importants.
> Aux posologies recommandées, elles bénéficient d’une bonne tolérance
neurologique, et exposent significativement moins le patient à des risques de
dyskinésies.
> Cette bonne tolérance neurologique rend plus manifestes les troubles
métaboliques, et notamment glucidiques, sans qu’ils soient plus importants
qu’avec les molécules conventionnelles.
> Les molécules atypiques exposent à un risque de prise de poids variable,
limité avec l’amisulpride (Solian), l’aripiprazole (Abilify) ou la
rispéridone (Risperdal, RisperdalOro).
> Il importe de souligner le profil particulier de la clozapine (Leponex),
qui bénéficie d’une bonne tolérance neurologique, n’expose pas à un risque de
dyskinésies tardives, mais implique une surveillance hématologique étroite
(risque d’agranulocytose parfois mortelle), hebdomadaire en début de
traitement, puis mensuelle, avec suivi de la NFS sur un carnet dédié à cet
effet, rempli et signé par le prescripteur, puis visé par le pharmacien.
Ce profil de tolérance neurologique favorable, du moins aux posologies
recommandées par les AMM, explique une meilleure compliance à la prescription
: leur utilisation en première ligne de traitement offre désormais aux
patients des avantages reconnus par les recommandations et les conférences de
consensus. Cette maniabilité autorise d’ailleurs le traitement par ce type de
médicaments des pathologies diver-ses :
– dans le cadre de l’AMM : extension d’indication aux troubles bipolaires
(olanzapine, rispéridone) ;
– hors AMM (à titre d’exemples) : syndrome de Gilles de la Tourette,
chorée de Hutinghton, certains types de démences, trou-bles du comportement
(agressivité notamment), certaines manifestations anxieuses.
Les antipsychotiques atypiques correspondent aux attentes actuelles du
psychiatre qui cherche moins à obtenir l’abrasion radicale des symptômes
productifs de la psychose chronique qu’à optimiser l’insertion sociale du
patient, en recourant à des molécules bien tolérées, peu « cami- solantes »,
permettant de privilégier le placement dans des structures non hospitalières
ou le maintien dans l’environnement familial. Ces possibilités sont élargies
par la commercialisation de présentations injectables de rispéridone (RisperdalConsta
LP IM, dans le traitement des psychoses, en particulier des psychoses
schizophréniques, en relais d’un traitement antipsychotique par rispéridone
orale) et d’olanzapine (Zyprexa injectable IM, dans le traitement des
épisodes d’agitation et des troubles du comportement chez les patients
schizophrènes, lorsque le traitement oral n’est pas adapté) venant s’ajouter
à l’amisulpride (Solian).
Les stratégies de traitement de la schizophrénie
Il convient de distinguer deux situations : – celle de l’urgence, dans le
cadre d’un accès aigu, où le médicament, administré à court terme, doit avant
tout entraîner une sédation suffisante du patient agité et un rapide
abrasement du délire et des manifestations hallucinatoires ;
– celle du traitement d’une psychose chronique, où le traitement doit à la
fois être actif sur l’ensemble de la symptomatologie (y compris déficitaire
et cognitive), et être bien toléré, notamment au niveau neurologique (on
privilégie désormais dans ce contexte l’administration d’antipsychotiques
atypiques) ; il faut souligner que le traitement d’une psychose chronique est
loin de reposer sur la seule chimiothérapie pour englober une prise en charge
institutionnelle à long terme (hôpital, appartement thérapeutique, hôpital de
jour ou de nuit, etc.) et une prise en charge sociale.
Episode psychotique aigu. Le traitement repose sur la
prescription d’un antipsychotique sous forme de gouttes, d’un comprimé
orodispersible ou de comprimés classiques, mais, surtout, la situation
l’imposant souvent, sous forme injectable pendant quelques jours, un relais
par voie orale étant instauré ensuite pour une durée variable selon la
situation.
Le recours au dropéridol injectable (Droleptan) a longtemps constitué une
référence, les formes injectables de chlorpromazine, d’halopéridol, de
cyamémazine ou de lévomépromazine ayant un délai d’action assez long. Mais
l’administration du dropéridol est limitée par sa mauvaise tolérance
cardiaque. Dans ce con-texte, l’amisulpride (Solian), la loxapine (Loxapac),
la cyamémazine (Tercian) ou l’olanzapine (Zyprexa) constituent des
alternatives privilégiées dans l’urgence psychiatrique. Si l’agitation est
importante, on peut associer de façon temporaire un antipsychotique sédatif
(lévomépromazine = Nozinan) ou un anxiolytique. La prescription d’un
correcteur des effets extrapyramidaux ne doit pas être systématique : il faut
attendre l’éventuelle survenue des effets indésirables neurologiques ou
choisir initialement une molécule donnant lieu à peu d’effets secondaires de
ce type. De même, le fractionnement posologique dans la journée, en gommant
les effets de pics, peut réduire les risques de survenue d’une hypotension
orthostatique. L’efficacité du traitement est sensible en quelques heures,
sur l’agitation ou les hallucinations, et dès la première semaine sur les
manifestations délirantes. Les doses étant ensuite réduites progressivement,
le traitement est poursuivi, en consolidation, sur une durée de trois à six
mois. S’il est inefficace, on change de molécule, en optant pour un produit
appartenant à une classe différente du premier et/ou l’on se repose la
question de la pertinence du diagnostic : il peut s’agir en effet d’un
trouble de l’humeur à traiter par un thymorégulateur, voire par
électroconvulsivothérapie.
Traitement au long cours.
> Choix de la molécule. Les recommandations actuelles
invitent à prescrire en première intention un antipsychotique atypique (bonne
tolérance neuro- logique et réduction de la symptomatologie négative
iatrogène, ces facteurs tendant à améliorer l’observance du traitement et à
permettre de gagner la confiance du patient, gage d’une alliance
thérapeutique de qualité). En cas d’échec de cette prescription, certains
experts recommandent l’essai d’une autre molécule atypique, d’autres
d’administrer une molécule conventionnelle. La prescription de clozapine (Leponex)
est recommandée après échec successif de deux antipsychotiques
(atypique-conventionnel ou atypique-atypique). > Posologie.
L’impératif tolérance fait désormais réduire substantiellement les posologies
des molécules conventionnelles, lorsqu’elles sont prescrites, par rapport aux
doses usuelles dans les années 1990. Quel que soit le type de traitement, la
posologie doit être augmentée progressivement, sur une semaine environ, pour
atteindre les doses moyennes recommandées par l’AMM. La monothérapie
constitue la règle dans le traitement du premier accès : elle facilite
l’observance et limite le risque de survenue d’effets indésirables.
L’administration de formes à libération prolongée ne peut trouver de place
dans le traitement initial d’une schizophrénie, sauf si la molécule a
préalablement été bien tolérée lors d’une administration orale, lors- que la
compliance au traitement s’impose d’emblée comme problématique.
> Evaluation du traitement. Une absence totale de réponse
clinique au traitement ne peut être évoquée qu’au terme de trois semaines à
huit semaines d’administration régulière de l’antipsychotique à posologie
stable. Ce n’est que passé ce délai qu’une évaluation clinique peut être
réalisée : elle implique le traitement symptomatique des signes morbides
persistants (anxiété, troubles du sommeil, agitation, etc., avec recours
fréquent à l’administration de benzodiazépines ou d’antipsychotiques sédatifs
à faible posologie), la prise en compte d’éventuels effets indésirables
(adaptation posologique, prescription de médicaments correcteurs, etc.).
En cas de réponse clinique partielle, le traitement doit être poursuivi
pendant deux à neuf semaines, sans tomber dans le piège d’une escalade
posologique. A terme, l’absence de réponse ou une réponse insuffisante font
envisager la prescription d’une autre molécule. En cas de réponse, le
traitement est poursuivi jusqu’à rémission des symptômes : en pratique, la
posologie est progressivement réduite toutes les deux à quatre semaines, sur
une période de plusieurs mois. Au bout d’une année de traitement environ,
lorsque la rémission obtenue semble de qualité, il est possible d’envisager
l’arrêt du traitement, sous surveillance étroite.
Si la rémission est inégale ou fluctuante, le traitement est poursuivi,
indéfiniment, jusqu’à rémission suffisamment durable ou, souvent, à vie. Dans
cette situation, il est classique de recourir à des formes injectables à
libération prolongée, qui permettent d’améliorer la compliance au traitement
chez des patients qui ont une forte propension à abandonner rapidement le
recours aux antipsychotiques. Très actifs, les antipsychotiques
conventionnels n’ont qu’une tolérance générale médiocre et, de plus, leur
formulation sous la forme de solutés huileux compromet également le confort
et la tolérance locale au site de l’injection intramusculaire. Il n’existe
actuellement qu’un antipsychotique atypique injectable, la rispéridone (RisperdalConsta,
présenté sous forme de microsphères pour administration IM toutes les deux
semaines, avec remise en suspension dans un soluté aqueux, et respect de la
chaîne du froid).
> Arrêt du traitement. Lors-que l’arrêt d’un traitement
antipsychotique est brutal ou trop précoce, le taux de rechutes atteint 50 %
dans les 30 semaines suivant le sevrage, mais n’augmente pas ensuite sur les
trois années qui suivent. En pratique, passé le cap des six premiers mois, la
majorité des patients n’ayant pas rechuté demeure stable. Mais on ne sait
encore prédire ceux chez lesquels les risques de rechute sont importants. Il
convient donc, dans tous les cas, de réduire la posologie du traitement
antipsychotique de façon progressive.
> Résistance au traitement. La notion de résistance au
traitement reste souvent confondue avec celle de rechute de la maladie. La
première caractérise l’impossibilité de réduire de façon satisfaisante les
signes cliniques de la maladie, alors que la seconde a trait à une récurrence
d’une pathologie ayant préalablement répondu au traitement. Des critères de
résistance dans la schizophrénie ont été proposés par divers auteurs. On
retient l’absence de rémission clinique ou sociale malgré la prescription
d’au moins deux médicaments antipsychotiques à posologie élevée pendant au
moins six semaines chez des schizophrènes sévères étroitement dépendants du
milieu hospitalier. Une résistance caractériserait de 5 à 25 % des cas de
schizophrénie.
Seule, aujourd’hui, la clozapine (Leponex) bénéficie d’une AMM dans les
formes résistantes aux autres traitements, utilisés en première ligne.
|